 es doctrines de l’inerrance et de l’inspiration verbale (infos ici) entraînent de fâcheuses conséquences théologiques, mais aussi au niveau de la recherche scientifique. Quand je regarde par exemple les recherches menées par les exégètes sur les origines du Pentateuque; quand les historiens tentent de reconstruire une histoire d’Israël en élaborant des hypothèses explicatives sur ses origines, comparant les données extra-bibliques, tenant compte des apports de l’archéologie, etc., je me demande quelle contribution à ces recherches ont offert et offrent les évangéliques francophones actuellement?
es doctrines de l’inerrance et de l’inspiration verbale (infos ici) entraînent de fâcheuses conséquences théologiques, mais aussi au niveau de la recherche scientifique. Quand je regarde par exemple les recherches menées par les exégètes sur les origines du Pentateuque; quand les historiens tentent de reconstruire une histoire d’Israël en élaborant des hypothèses explicatives sur ses origines, comparant les données extra-bibliques, tenant compte des apports de l’archéologie, etc., je me demande quelle contribution à ces recherches ont offert et offrent les évangéliques francophones actuellement?
Comment est-il possible de participer à la recherche si l’on tient par principe que Moïse est le rédacteur du Pentateuque et que les récits bibliques sont historiques [1]? Non seulement la participation à la recherche est difficile, mais toute recherche authentique — c’est-à-dire indépendante, critique et la plus objective possible — est en elle-même rendue impossible. Sauf si, bien entendu, cette recherche se donne une finalité bien particulière et se mue en idéologie: défendre, voire démontrer, l’exactitude historique et la vérité de la Bible et, le corollaire obligé de cette démarche, critiquer toute recherche ne partageant pas cette même ambition et dont les résultats contrarient ou mettent en doute l’exactitude historique de la Bible. Par ailleurs, ce qui vaut en histoire, vaut également dans les sciences de la nature, avec le créationnisme.
Bien qu’existante, la séparation n’est pas absolue. L’approche évangélique des sciences n’exclut pas la recherche scientifique quand celle-ci se rapporte à un objet d’étude réduit, limité, local, ou, tout au plus, à un sujet dont les implications ne touchent pas à la sacro-sainte inerrance biblique [2]. De plus, ces limites imposées à la recherche n’excluent aucunement l’érudition dont peuvent faire preuve certains exégètes et historiens évangéliques [3].
L’histoire
Pour les évangéliques qui croient par principe à l’historicité des récits bibliques, les avancées de l’histoire et de l’archéologie n’ont plus qu’un rôle de confirmation. La Bible affirme, les sciences confirment. Cette idée est exprimée de manière franche et directe par Émile Nicole, professeur d’Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. En lisant l’un de ses articles, j’ai été agréablement surpris de l’autonomie accordée à la recherche archéologique. Je suis toutefois tombé des nues quand j’en ai lu la raison:
Croyant que la Bible dit vrai, nous avons tout à gagner qu’un témoignage indépendant soit porté sur les faits qu’elle rapporte. Laissons donc la recherche archéologique se poursuivre de manière indépendante, son témoignage n’en aura que plus de poids lorsque des confirmations évidentes apparaîtront […]. — (La Bible dévoilée?, Théologie évangélique, 2/2, 2003, p. 106)
Cette autonomie concédée à l’archéologie n’est qu’apparente, puisque son but manifeste est de témoigner de la vérité de la Bible, de « repérer les empreintes laissées par Dieu dans l’histoire antique » (p. 110). Quand, à la place de confirmer, l’archéologie met en question l’historicité de la Bible, Nicole est obligé de trouver toutes sortes d’échappatoires: manque d’objectivité des archéologues, approche biaisée, scepticisme de principe, limites et incertitudes de l’archéologie, etc. Comment pourrait-il en être autrement? Ainsi, l’histoire et l’archéologie sont des sciences respectables lorsqu’elles servent à confirmer l’historicité de la Bible; elles ne démontrent, dans le cas contraire, que le scepticisme ambiant, un biais idéologique implicite ou tout autre poison mortel mis à nu par l’apologétique. Voilà à quoi se réduit bien souvent la participation évangélique à la recherche académique: une apologétique perpétuelle.
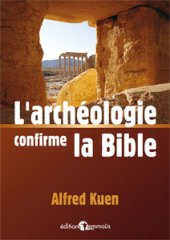 Dans cette même logique de « confirmation », certains auteurs versent dans le triomphalisme. Selon Henry C. Thiessen « les découvertes archéologiques ont grande-ment contribué à confirmer la précision historique de l’Ancien Testament. » [4] Dans le Nouveau Dictionnaire Biblique (Emmaüs, 1992), nous lisons à l’entrée « Archéologie » que « des hommes remarquables ont illustré cette science. Dieu s’en est servi pour confirmer les récits bibliques » (p. 111). Ajoutons que l’infatigable Alfred Kuen intitule son dernier ouvrage L’archéologie confirme la Bible! À l’opposé de ce qu’il faut bien appeler des outrances d’un autre âge, Matthieu Richelle — un chercheur évangélique — se montre plus prudent (La Bible et l’archéologie).
Dans cette même logique de « confirmation », certains auteurs versent dans le triomphalisme. Selon Henry C. Thiessen « les découvertes archéologiques ont grande-ment contribué à confirmer la précision historique de l’Ancien Testament. » [4] Dans le Nouveau Dictionnaire Biblique (Emmaüs, 1992), nous lisons à l’entrée « Archéologie » que « des hommes remarquables ont illustré cette science. Dieu s’en est servi pour confirmer les récits bibliques » (p. 111). Ajoutons que l’infatigable Alfred Kuen intitule son dernier ouvrage L’archéologie confirme la Bible! À l’opposé de ce qu’il faut bien appeler des outrances d’un autre âge, Matthieu Richelle — un chercheur évangélique — se montre plus prudent (La Bible et l’archéologie).
Dans Comment interpréter la Bible (Emmaüs, 1991), Alfred Kuen esquive complètement le problème du rapport entre Bible et histoire. Un chapitre du livre consacré au « contexte historique, géographique et culturel » est présenté comme une des étapes de l’interprétation biblique, qui doit être attentive aux contextes historiques et culturels de la Bible. L’histoire et l’archéologie sont ainsi instrumentalisées et d’usage ponctuel au fil des textes, réduites à un rôle d’aide, d’illustration et de clarification. Le présupposé fondamental est que « toutes les paroles et tous les événements relatés dans la Bible sont […] intimement liés à leur temps » (p. 97). L’idée induite par l’approche de Kuen est que les récits de la Bible sont tous historiques et que le seul obstacle à leur compréhension réside dans leur distance dans le temps. Ce qui se résout en partie par la contextualisation. C’est exactement la recette mise en oeuvre dans les « histoires bibliques d’Israël »: la Bible sert de trame historique que les apports de l’archéologie viennent consolider [5], obtenant ainsi un ouvrage prétendument « d’histoire » mais dont le caractère consiste davantage dans une paraphrase [6]. Si l’on pousse cette logique à son extrémité, il suffirait pour réaliser une « histoire biblique » de munir nos Bibles de notes culturelles et historiques!
Le Pentateuque
On peut le comprendre, les auteurs évangéliques n’ont pas de réel intérêt pour la recherche académique et son évolution sur les origines du Pentateuque. C’est pratiquement en vain qu’une telle recherche existe, puisque le rédacteur principal du Pentateuque a toujours été, est définitivement et sera à jamais, Moïse. Quand ces auteurs — exégètes, historiens ou dogmaticiens — abordent le sujet, c’est dans le seul et unique but de rappeler à leurs lecteurs que la théorie documentaire est erronée et contraire à la foi. Bien que la profondeur du traitement diffère en fonction de l’ouvrage et du public visé, les conclusions sont toujours les mêmes.
Recherche en crise, fin de la recherche?
Un fait significatif mérite d’être relevé. Depuis les années 90, les publications évangéliques — livres ou articles — critiquant la recherche sur le Pentateuque ne manquent pas de relever la phase de remise en question qui traverse effectivement le monde universitaire [7]. C’est le cas de Brian Tidiman qui, dans son Précis d’histoire biblique d’Israël (p. 28-29), signale que « le crédit accordé à ces théories, longtemps admises dans le monde universitaire, se perd depuis quelques années, parfois chez leurs propres partisans« . Ce que Tidiman ne dit pas, ou plutôt dissimule, c’est que ce qui « se perd » en réalité, c’est la théorie « classique » des sources, non le fait — admis par tous les spécialistes — qu’il y ait plusieurs sources, plusieurs fragments et divers auteurs à l’origine du Pentateuque. Même chose chez le dogmaticien luthérien Wilbert Kreiss, dans un article paru dans La Revue réformée [8], qu’il serait plus exact de qualifier de prêche. Fort de citations habilement sélectionnées d’universitaires engagés dans cette crise, il déclare: « Le glas semble avoir définitivement sonné pour l’hypothèse documentaire et ses variantes. » (p. 67) Comme Tidiman, il donne l’impression que le tout de la recherche est à jeter à la poubelle — si je puis m’exprimer ainsi —, que les spécialistes enterrent leurs théories et font leur mea culpa, pour n’avoir plus qu’à revenir à la traditionnelle attribution mosaïque du Pentateuque [9]. Rien n’est plus faux. Ce qui est remis en question, c’est un modèle explicatif particulier — certes dominant —, pas la recherche en soi. La recherche sur le Pentateuque évolue, se poursuit, et de nouvelles pistes sont proposées [10]. En fait, ce que voudrait Kreiss, c’est purement et simplement l’abolition des méthodes historico-critiques, pour revenir à la « ‘critique’ légitime de l’Écriture » telle que la pratiquait Luther (p. 52)! Ce qui, évidemment, ne risque pas d’arriver, à moins que soit découverte la machine à remonter le temps.
Sois orthodoxe et tais-toi!
Le second élément que je retiens, c’est bien entendu la prétendue incompatibilité des théories développées par la recherche biblique avec l’inspiration de la Bible, telle qu’elle est conçue et définie par les évangéliques. Tidiman écrit: « Ce traitement du Pentateuque va souvent de pair avec le refus de reconnaître son inspiration divine« . Kreiss va dans le même sens:
[…] la conviction de tous ceux qui ont participé à la genèse des différentes techniques de la méthode historico-critique est qu’il n’existe pas de dogme de l’inspiration qui la classe dans une catégorie à part et la soustraire à une telle critique. — (p. 53)
Kreiss sait se montrer extrêmement ferme envers quiconque aurait des doutes: « C’est une théorie à laquelle nous n’avons pas le droit de souscrire. Notre foi en l’origine divine et l’inspiration de la Bible nous l’interdit. » (p. 66; il souligne) Kreiss appelle aussi à la repentance et au retour à l’orthodoxie [11]:
La traditionnelle hypothèse documentaire […] a perdu aujourd’hui toute crédibilité dans les lieux spécialisés qui avouent leur perplexité et ne savent pas dans quelle direction orienter leurs recherches. Peut-être pourraient-ils tout simplement souscrire à la foi traditionnelle en l’authenticité mosaïque du Pentateuque, si les a priori philosophiques de leur théologie ne leur interdisait [sic] pas… — (p. 60)
Comme l’a dit — si je ne me trompe — un hérétique des temps modernes, Alfred Loisy: une homélie ne peut être réfutée!
Conclusion
Il est communément admis par les auteurs évangéliques que le caractère inspiré de la Bible lui confère un statut particulier, à part de tout autre ouvrage, tant du point de vue de la foi que du point de vue de la recherche scientifique. Si je peux comprendre et parfaitement admettre que la Bible soit un livre à part du point de vue de la foi, je ne vois pas pourquoi il faudrait la soustraire à la critique historique ou lui réserver un traitement spécial. Je ne vois pas davantage en quoi consisterait cette différence dans la pratique et le concret de la recherche. Sauf si cette différence ne se joue pas dans le cours de la recherche mais dans ses présupposés dogmatiques, ce qui est manifestement le cas de la théologie évangélique. C’est entendu: La Bible est historique; Moïse a écrit le Pentateuque. Deux faits élevés au rang de doctrines.
La mosaïcité du Pentateuque soulève aussi la question de la pseudépigraphie qui, par principe, ne peut être admise par un évangélique, car celle-ci est de facto assimilée à une tromperie mettant en cause l’intégrité morale de Dieu. Si Jésus attribue le Pentateuque à Moïse, alors c’est indiscutablement Moïse qui doit l’avoir écrit, sans se demander si cette attribution ne doit pas plutôt être comprise comme étant de l’ordre du traditionnel, non comme l’indication d’une vérité factuelle.
Suite à ce qui a été exposé dans cet article, il n’y a rien d’étonnant à ce que les exégètes et historiens qui ne partagent pas les convictions évangéliques fassent très peu si ce n’est pas du tout référence à leurs travaux. Comment le leur reprocher? Pourtant, grâce aux exigences scientifiques de la recherche universitaire, notamment biblique, cette dernière rassemble en son sein des spécialistes issus du catholicisme, du protestantisme et du judaïsme indistinctement. Bien sûr, je vois l’argument venir: ce sont tous des libéraux!
Les évangéliques ne cesseront jamais de me fasciner.
______________________________
1. Voir ce qu’écrit Émile Nicole face aux théories relatives à l’installation des israélites en Canaan: « Il appartient à ceux qui, comme nous, croient par principe à la fiabilité historique de ces récits d’examiner les problèmes qui se posent […]. » À la fin de son article, il récidive et parle de « ceux qui croient à l’exactitude historique de ces récits » (« L’installation des Israélites en Canaan« , Fac-réflexion n° 17, octobre 1991, je souligne). On le voit: vérité, inspiration et historicité sont étroitement liés, de sorte que la position évangélique se trouve complètement cadenassée. Jean-Pierre Berthoud est du même avis que Nicole, quand il écrit que « si la Bible est vraie, elle doit l’être dans tout ce qu’elle dit, dans ses affirmations géographiques, archéologiques, historiques et scientifiques, autant que dans ce qu’elle déclare sur le plan spirituel et théologique » (Création, Bible et science, p. 265). Henri Blocher confirme l’idée en confessant « la vérité intégrale, à tous les niveaux, de la Parole de Dieu. Donc aussi en histoire » (« Histoire, vérité et foi chrétienne« , Théologie évangélique vol 7, n°2, p. 134).
2. Par exemple, il est communément admis dans la recherche néotestamentaire, plus spécifiquement paulinienne, que 7 épîtres sur les 13 sont incontestablement de Paul, tandis que les autres sont sujettes à débat. Si un exégète évangélique travaille sur une épître incontestée comme celle aux Galates, il n’aura aucun mal à admettre son authenticité, voire à renforcer son point de vue en citant des exégètes de renommée internationale. Par contre, s’il s’agit d’une épître dont l’authenticité paulinienne est largement contestée, comme la première ou la seconde à Timothée, l’exégète évangélique, ne pouvant souscrire à une telle option, est obligé de se mettre sur la défensive et déployer un argumentaire dont la logique explicite ou implicite est motivée par la doctrine de l’inerrance et celle de l’inspiration verbale qu’il professe. L’accumulation de tels cas amène à des positions curieuses, suspectes d’un point de vue académique.
3. Un brillant exemple en matière d’histoire est donné par l’égyptologue anglais Kenneth A. Kitchen, qui a publié en 2003 (rééd. en 2006) une somme à l’intitulé programmatique: On the Reliability of the Old Testament. Dans le domaine de la théologie systématique, Henri Blocher fait preuve d’une pénétrante et vaste érudition, restituant avec acribie la pensée de ceux qu’il critique. En exégèse, je vois un équivalent chez Samuel Bénétreau, dont j’apprécie particulièrement les travaux.
4. Dans Esquisse de théologie biblique, Marne-la-Vallée / Lennoxville (Quebec), Farel / Bethel, 1995 (2e éd. française; 1re éd. angl. révisée 1979), p. 81.
5. Dans certains cas, les apports de l’archéologie ne suffisent pas. Par exemple, la plupart des exégètes et historiens évangéliques abordent tout à fait sérieusement une question liée au déluge (Gn 6-9), a savoir si son étendue fut locale ou universelle. Les tenants de l’une et de l’autre position recourent à des arguments de type ethnologique (histoires antiques relatives à un déluge), géologique, paléontologique, voire biologique. Pour une belle compilation des arguments en présence, voir Alfred Kuen, Encyclopédie des difficultés bibliques, vol 1. Pentateuque, Emmaüs, 2006, p. 121-132. Un autre exemple réside bien sûr dans le récit de la création, dont certaines lectures littéralistes — ou plutôt « scientifiques » — font appel à des arguments issus des sciences naturelles ou dures. Dans tous les cas, le récit biblique, préalablement conçu comme intégralement historique, fait office de réceptacle des diverses théories de tous ordres censées en expliquer le contenu. L’interprétation sombre bien souvent dans un naturalisme qui frise parfois le ridicule.
6. Dans cette veine, le livre de Werner Keller, publié pour la première fois en allemand en 1956 — La Bible arrachée aux sables —, est paradigmatique. Voir aussi les travaux de Kenneth A. Kitchen, déjà cité; Brian Tidiman, Précis d’histoire biblique d’Israël, Nogent-sur-Marnes, Institut biblique de Nogent, 2006, dont le sous-titre prête à sourire: « De la création [!] à Bar-Kochba »; sous la forme d’atlas, voir Paul Lawrence, Atlas de l’histoire biblique, Cléon d’Andran (France), Excelsis, 2009; d’un point de vue juif engagé, voir André et Renée Neher, Histoire biblique du peuple d’Israël, Paris, Adrien Maisonneuve, 19884 (1re éd. 1962). Moins caricatural que le précédent, touffu (700p), mêle érudition et édification.
7. Sur le sujet, voir l’ouvrage collectif sous la direction de Albert de Pury et Thomas Römer, Le Pentateuque en question, Genève, Labor et Fides, 2002 (3e éd. revue et augmentée), premièrement paru en 1989, reprenant une série de conférences de 3e cycle données en 1986/87. Tidiman et Kreiss y font référence.
8. « Que penser de la critique du Pentateuque? », La Revue réformée n° 186, 1995, p. 51-67.
9. C’est le même genre de raisonnement qui est appliqué par les créationnistes à la théorie de l’évolution. Ses inconnues et ses faiblesses l’invalideraient totalement, en faveur bien évidemment du modèle « scientifique » créationniste. Kreiss fait lui-même le parallèle: « Se pourrait-il que la critique du Pentateuque connaisse le sort de la théorie de l’évolution articulée par Darwin? Qu’elle survive dans l’esprit de beaucoup de gens, bien qu’elle soit scientifiquement indémontrable et même discréditée, parce que, faute de vouloir souscrire au créationnisme, on ne lui a pas trouvé de substitut satisfaisant? » (p. 62) Quel hasard que les évangéliques qui rejettent la recherche du Pentateuque, et les méthodes historico-critiques en général, soient à peu près les mêmes qui rejettent la théorie de l’évolution… Cela dit, je ne conteste pas que l’on puisse porter un regard critique, au contraire, ni même rejeter telle pratique ou telle théorie. Ce que je conteste, ce sont les raisons invoquées et la logique dogmatique sous-jacente.
10. Voir p. ex. en ligne l’histoire de la recherche tracée par Thomas Römer: « La formation du Pentateuque selon l’exégèse historico-critique » (sans date; vers 1994-95 si l’on s’en tient aux dates des publications citées dans les notes). À partir du bas de la page 10 (« La contestation de la théorie documentaire »), il expose les raisons de cette contestation et les nouvelles voies d’exploration. Pour une histoire plus récente de la recherche, je renvoie à la 4e édition de l’Introduction à l’Ancien Testament publiée en 2009.
11. Sur l’argument de l’orthodoxie, j’espère écrire un article à part entière.
Benoit H.
11 janvier 2012 at 11:48
Article d’une grande pertinence, mais je crois que les lignes sont en train de bouger, parce que de plus en plus d’évangéliques réalisent l’impasse intellectuelle d’une telle approche. En voici des exemples sur mon blog. Mon rêve secret est que ce qui fait la force spirituelle des mouvement évangéliques puissent enfin s’allier avec plus rigueur intellectuelle!
http://cvablog.com/creationetevolution/2011/07/07/les-deux-auteurs-de-genese-1-11/
http://cvablog.com/creationetevolution/2011/09/07/les-preuves-bibliques-et-linguistiques-des-deux-auteurs-de-genese-1-11-14/
Georges Daras
11 janvier 2012 at 19:09
À vrai dire, j’entretiens également le souhait que les évangéliques (notamment francophones) s’approprient pleinement les acquis des avancées historico-critiques en laissant tomber leurs crispations doctrinales concernant la Bible. Bien souvent, je suis déçu par le manque de rigueur, de logique et de réflexion (on a souvent droit à des réponses simplistes aux problèmes), qu’ils remplacent quand ils se sentent attaqués par des affirmations qu’ils considèrent comme des marques de piété et de fidélité au Dieu de la Bible. C’est malheureusement là où ils se trompent. En évoluant dans le sens proposé, mon autre souhait est que les évangéliques restent les évangéliques, qu’ils gardent leur dynamisme et leurs aspirations (tout en veillant à ne pas tomber dans les excès), et en ce sens je n’hésite pas à dire que je suis avec eux un protestant évangélique.
Benoit H.
25 janvier 2012 at 15:04
Bonjour Daras,
Encore merci pour ta participation au blog création évolution. Serais-tu prêt à renouveler l’expérience avec cet article que nous pourrions poster en 2 fois? Il est vrai que tu l’as déjà mis en lien…
Fraternellement
Benoit
Georges Daras
25 janvier 2012 at 17:12
Bonsoir,
Oui, pas de problème. Je ne sais pas comment tu t’y prends pour rééditer mes articles, mais je peux éventuellement te faciliter la tâche en t’envoyant la version html.
À bientôt!
Daras
PS: Il me semble que tu n’as pas répondu à la proposition émise dans un de mes commentaires à propos de Siegwalt. Voir ici.
Benoit H.
25 janvier 2012 at 19:08
Merci Daras, ta première série d’articles a connu un bon succès. Près de 700 visites la semaine dernière!
Je n’avais pas vu ta proposition à propos de Siegwalt, merci bcp! Envoie moi un mail à la rubrique contact du site science et foi pour que je puisses t’envoyer mon adresse perso.
Pour publier, je fais simplement un « copié collé » à partir de ton site. ça marche bien. Je te qualifierai cette fois ci « d’évangélique critique » puisque c’est ton expression sur le blog.
Georges Daras
25 janvier 2012 at 21:23
Beaucoup de visites et pas mal de réactions, en effet!
C’est ok pour évangélique critique.
À bientôt!
gakari1
20 mars 2012 at 08:39
Bonjour,
Je viens de terminer le livre de Matthieu Richelle, « La bible et l’archéologie », que j’ai trouvé très intéressant (tout comme son blog, soit dit en passant).
Je crois lire entre les lignes qu’il n’a pas la même conception de l’inspiration que vous, Daras, et qu’il soutient une datation plus ancienne des écrits (avec arguments qui, pour un non spécialiste comme moi, sont signifiants).
Ce serait vraiment intéressant que vous confrontiez vos arguments.
Je suis assez d’accord avec lui sur le silence de preuves archéologiques qui sont interprétés trop rapidement comme des preuves de non-historicité du récit biblique par les scientifiques. Par les spéculations qui deviennent dogmes tant du côtés des sceptiques que des fondamentalistes.
Mais je regrette qu’il n’aborde pas les points historiques qui fâchent dans le texte, les différentes théories de composition des textes qui touchent aussi à la façon dont nous pouvons aborder l’aspect historique, enfin qu’il reste aussi « évangéliquement correct ».
Le chapitre consacré à la réponse aux théories de Finkelstein est clairement expliqué, et j’ai bcp aimé la conclusion du livre qui reflète une certaine humilité que j’apprécie et dont devrait s’inspirer certains auteurs évangéliques.
À lire, donc.
Yannick
Georges Daras
20 mars 2012 at 12:32
Bonjour Yannick,
Merci de me faire part de vos impressions de lecture. Elles m’intéressent!
Je reste néanmoins sur ma faim! J’aurais aimé avoir davantage de précisions sur ces « datations plus anciennes » dont vous parlez. De quels écrits il s’agit?
Je vous rejoins dans vos remarques (silence de preuves et leur interprétation). J’en ferais deux pour ma part: sur les points que vous regrettez ne pas voir aborder par Richelle, cela tient sans doute au caractère introductif de l’ouvrage (que je n’ai pas lu, si ce n’est la table des matières).
Ensuite, je dirais que les questions de datation des textes sont une affaire extrêmement complexe car elles mettent en jeu une variété de disciplines. Bien souvent, nous en sommes réduits à de fragiles hypothèses et à des inconnues persistantes (il faut p. ex. lire une histoire de la recherche pour s’en convaincre). Je dois bien avouer que je ne suis qu’un amateur en matière de datation des textes, m’étant particulièrement spécialisé dans le versant plus littéraire (narratif) de l’exégèse.
Le livre de Finkelstein et Silberman (La Bible dévoilée) a même été critiqué par des spécialistes critiques, notamment pour son archéologisme (l’archéologie comme critère du vrai et du faux; n’articule pas bien exégèse et archéologie), bien qu’il y ait, je pense, un accord de fond sur l’historicité. Je ne m’étonne pas que Richelle ait son mot à dire à ce sujet. Mais qu’entendez-vous par « évangéliquement correct »?
Enfin, comme je ne manque pas de le répéter, je n’ai pas de théorie de l’inspiration fixée de A à Z. Je m’élève simplement contre les abus, ce que j’estime être des dérapages, de fausses pistes, de faux débats. Les évangéliques ont beaucoup compliqué les choses parce qu’ils ont mêlé à la question de l’inspiration l’histoire, l’archéologie, voire la biologie, la physique, la paléontologie, etc., versant dans une apologétique perpétuelle. Pour moi, les choses sont plus simples, parce que je distingue ce qui est de l’ordre de la foi et ce qui l’est de la raison, ce qui est discours de foi et ce qui est production de la raison. Il y a distinction des plans. Ce qui n’implique pas séparation, mais articulation. Il n’y a pas d’harmonisation ni hiérarchisation possibles (puisque les plans sont différents), mais inévitable tension qu’il faut constamment savoir gérer en assumant les limites de nos possibilités. Car, en fin de compte, l’inspiration touche d’une certaine manière à la connaissance de Dieu et de son agir dans le monde. Or, « nous voyons aujourd’hui au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu » (1 Co 13.12). Je n’en dis pas plus.
Merci encore pour votre commentaire!
Georges
gakari1
21 mars 2012 at 18:39
Merci pour la mise au point concernant l’inspiration. C’est donc bien une conception différente que celle de la tradition évangélique (ce n’est pas une critique) et je crois qu’elle a un impact sur le scientifique chrétien ou pas, même le plus honnête et le plus rigoureux.
Les datations dont je parle concernent surtout les écrits des règnes de David et Salomon. J’espère ne pas prêter de fausses idées à Matthieu Richelle, mais il défend l’idée que ces textes aient pu être contemporains des personnages racontés.
Et je pense qu’il ne soutient pas vraiment plusieurs traditions orales mises par écrits, regroupées, puis peut-être modifiées par la suite.
Les arguments sont bons (pour les connaitre, il vaut mieux lire le bouquin) mais leur valeur ne peut-elle pas être amoindrie par l’exégèse, justement ?
Par « évangéliquement correct », j’entends ne pas essayer de sortir des sentiers battus par la tradition évangélique (auteur du pentateuque, inspiration, etc.).
Mais je crois que vous avez raison, ce n’est pas le propos du livre, qui explique les limites de l’archéologie, les alternatives tout aussi scientifiques et recevables aux théories les plus médiatiques (pas forcément les plus approuvées par la communauté scientifique), et qui met en valeur le texte biblique à la lumière des dernières découvertes.
J’ai juste trouvé dommages de ne situer les obstacles que dans une mauvaise interprétation archéologique et/ou scientifique et de ne pas parler des limites du texte biblique lui-même, qui situe son message ailleurs, peut-être, que dans des considérations historiques au sens moderne.
Yannick
Georges Daras
21 mars 2012 at 19:29
Bonsoir Yannick,
Vous avez raison, ce qu’il me reste à faire c’est de lire le livre!
Des textes remontant aux règnes de David et Salomon, c’est vrai que la recherche ne va pas jusque-là. Quelques-uns admettent tout au plus qu’il y ait dans ces textes quelques traditions orales remontant à cette époque, mais leur contour est vague. Quant aux multiples couches littéraires, c’est un acquis certain. Pour la mosaïcité du Pentateuque, on n’en parle même pas, c’est exclu. Même au niveau des traditions orales. Étant donné l’important travail rédactionnel et littéraire dans la Bible découvert ces dernières décennies, il est difficile de parler de tradition orale ou pré-littéraire.
Cela dit, si vous vous montrez prudent pour ne pas mal interpréter Richelle, je me garderais bien a fortiori d’émettre le moindre jugement à son égard.
Je ne vois pas ce dont la valeur est amoindrie par l’exégèse, et en quoi l’exégèse produit un tel effet. Si vous pouviez m’éclairer à ce sujet.
Cordialement
gakari1
22 mars 2012 at 08:34
Bonjour,
Les arguments de M. Richelle ne contredisent pas forcément les datations récentes de l’at, ils émettent des doutes sur ces « nouvelles » théories et avancent qu’il est tout à fait probable que le peuple sémite ait pu avoir des scribes produisant des parchemins qui ne se soient pas conservés jusqu’ici avant le 9ème siècle (j’espère ne pas me tromper d’explications, j’écris de mémoire et suis novice en la matière).
Les peuples conquis en avait certainement (à destination commerciale, surtout), pourquoi pas le royaume d’Israel ?
C’est un argument valable, je trouve, et si le seul contre-argument archéologique est qu’il n’y a pas de découvertes d’écrits sémites aussi vieux, je me demande, du point de vue de l’exégèse historico-critique, ce qui pourrait aller dans le sens de la critique moderne, cad des écrits plus tardifs et réactionnaires aux peuples assyrien et babyloniens.
Yannick
Georges Daras
22 mars 2012 at 10:29
Bonjour Yannick,
Merci pour cet effort d’éclaircissement! Encore une fois, je ne peux émettre de jugement. Ce que je sais, c’est que Richelle s’est spécialisé dans ce genre d’enquête et que son point de vue mérite d’être connu. J’aurais peut-être l’occasion de présenter son livre et de proposer une petite interview. Nous verrons bien s’il accepte ma demande!
Georges
gakari1
13 juin 2012 at 06:29
Bonjour,
Concernant l’archéologie biblique, on peut aussi relever le magazine le Monde le la bible qui propose un numéro intitulé « L’archéologie contredit-elle la bible ? » (http://www.mondedelabible.com/actualites/larcheologie-contredit-elle-la-bible-en-kiosque-et-en-librairie/)
En réponse au livre de Kuen 🙂
Yannick
Georges Daras
13 juin 2012 at 21:04
Merci Yannick pour l’info!
Cordialement
gakari1
19 avril 2013 at 10:55
Bonjour Georges,
Comment va ?
Je suis retombé sur ton article dans une recherche google et j’ai relu les commentaires.
Je voudrais juste modifier une phrase que j’ai écrite. Je cite :
« …ce n’est pas le propos du livre (de Mr Richelle), qui explique les limites de l’archéologie, les alternatives tout aussi scientifiques et recevables aux théories les plus médiatiques (pas forcément les plus approuvées par la communauté scientifique) »
Après pas mal de lecture de publications, de recherche, je dois admettre que beaucoup de points des théories de Finkelstein font aujourd’hui pratiquement consensus internationalement chez les scientifiques et archéologues, en particulier chez ceux qui sont ou étaient sur le terrain. C’est vrai que Finkelstein est un homme médiatique, mais son travail est tout autant sérieux, minutieux et précurseur.
On ne met plus en doute le fait que les proto-israélites soient des cananéens, s’il y a des divergences c’est plutôt sur quelle sorte de population ils étaient (rebelles des citées états, nomades, bergers, regroupement politique, etc.). On peut aussi très difficilement valider le royaume unifié de David et Salomon, à moins de se retrouver face à des contradictions insurmontables.
Je m’interrogeais sur la place prépondérante que l’on donnait à l’absence de preuves scientifiques de l’histoire telle que racontée dans la bible, mais aujourd’hui, les preuves s’accumulent et contredisent l’historiographie biblique pour qui veut chercher (n’en déplaise à Kuen), que ce soit dans le domaine de la linguistique synchronique et diachronique, de la géographie (anachronismes), et bien sûr de l’archéologie. En complément, l’exégèse, venant confirmer tout cela.
Il y a d’ailleurs le cas intéressant de William G. Dever, ayant écrits des ouvrages apologistes plutôt maximalistes, qui, par la force des choses, sur le terrain des fouilles en Israël, est devenu minimaliste (bien qu’il ait une théorie différente de Finkelstein). (En passant, il est passé de pasteur baptiste à agnostique, mais c’est une autre histoire).
Tout ceci pour dire, in fine, que je n’ai pas lu le livre de Kuen, mais je reste perplexe. Il est en général exhaustif en étude comparée (de ce que j’ai pu lire), et là, il intitule son livre « L’archéologie confirme la bible »… C’est soit très naïf, soit il manque des mots du genre « L’archéologie (du 19ème siècle) confirme la bible », soit c’est de l’humour (ce dont je doute), soit il a mal étudié son sujet, ou bien, d’autres choses qui sont moins glorieuses et qui m’amène à décrédibiliser toujours plus les champions de l’inerrance biblique.
Yannick
Georges Daras
21 avril 2013 at 12:40
Bonjour Yannick,
Merci pour ce partage. On peut effectivement résumer comme tu le fais. Mais je ne pense pas que Dever soit minimaliste. Sauf erreur de ma part, je pense qu’il se situe dans une voie médiane à la Finkelstein. Les minimalistes sont parfois un peu marginalisés, comme Niels Peter Lemche, Thomas L. Thompson ou encore Philip R. Davies.
Quant à Kuen, le lire serait une pure perte de temps et d’argent (à supposer que tu achètes son livre). On connaît la méthode qui consiste à sélectionner les thèses en fonction de l’axe fondamental selon lequel la Bible est la-parole-infaillible-de-Dieu-qui-ne-saurait-mentir-ni-tromper. Puisque c’est la Bible, l’archéologie ne pourrait que la confirmer. Il n’y a pas d’erreur dans le titre. C’est aussi subtil que cela l’apologétique à la Kuen. Je n’ai même pas besoin de lire son livre pour le savoir. C’est toujours la même chose.
À part l’angle archéologique, il y a également l’angle littéraire qui lui est lié. Les deux se confirment. L’angle littéraire qui occupe les exégètes nous montre une rédaction tardive des récits bibliques, pas avant les VIII-VIIe siècles, surtout rédigés autour de l’exil, donc VI-IVe siècles et plus tard encore (par ex. une partie de Daniel au IIe siècle). L’angle littéraire rend pratiquement impossible l’historicité de quoi que ce soit avant une royauté déjà bien avancée.
Moi j’y ajoute également un élément théologique qui tient compte de la vision ancienne du monde et de Dieu totalement différente de la nôtre. Si l’on s’en tient aux récits bibliques, les anciens Israélites voyaient Dieu agir partout, dans les éléments de la nature, les tremblements de terre et les famines, il est impliqué dans les guerres de son peuple, tenant les manettes géopolitiques de l’époque (par ex. il soulève une nation pour aller punir Israël), c’est lui qui fait la santé et la maladie, rend les femmes stériles ou fertiles, puni de mort ou promet une longue vie, communique des lois et des rituels précis, etc. Bref, Dieu est tellement présent et impliqué dans les affaires de son peuple qu’on peut se demander s’il est possible aujourd’hui de maintenir une telle vision archaïque des choses, ce que par ailleurs personne ne fait en pratique (en attribuant par ex. telle catastrophe naturelle à une punition divine). Tout cela pour dire que cela ne gênait pas les écrivains bibliques d’être très inventifs dans les récits qu’ils écrivaient…
Enfin, j’ai bien pris note du changement que tu souhaitais opérer, mais je ne vois pas dans quel sens. Dois-je simplement ajouter « de Mr Richelle » entre parenthèses? Si tu pouvais me donner plus de précisions. Merci.
À bientôt et au plaisir de te lire!
Georges
gakari1
22 avril 2013 at 10:17
Bonjour Georges,
En effet, je me suis mal exprimé, je ne veux pas que tu modifies ma phrase (ce qui est écrit est écrit), je voulais juste exprimer le fait que les thèses de Finkelstein, qui s’affinent avec le temps, sont aujourd’hui accueilli avec bien plus de considérations.
Sinon, assez d’accord avec toi sur l’ensemble.
Bonne journée.
Yannick
Patrick
31 mars 2014 at 17:00
Je suis vraiment impressionné par la qualité des commentaires et de l’esprit critiques qui se dégage de votre blog. Mais je regrette autant soit peu, le manque de considération spirituelle, que même un esprit logique peut avoir. Je voudrais savoir comment peut on interpréter ce texte à la lumière du débat scientifique sur la Bible, Or l’homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles lui sont folie; et il ne peut les connaître, parce qu’elles se discernent spirituellement. (1Co 2:14)? Merci
Georges Daras
7 avril 2014 at 12:16
Bonjour Patrick,
Merci pour votre commentaire et votre appréciation. Quant à votre question, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « manque de considération spirituelle »?
Sébastien Thorel
12 juillet 2015 at 11:11
http://scienceetbible.com
Georges Daras
12 juillet 2015 at 11:17
http://www.scienceetfoi.com
Sébastien T
21 août 2015 at 14:22
Bonjour,
http://scienceetbible.com
Cordialement,
Sébastien T
Georges Daras
21 août 2015 at 15:35
Bonjour,
http://www.scienceetfoi.com
Cordialement,
Georges